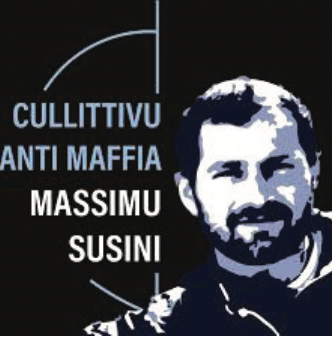La Corse expérimentera bientôt un dispositif inédit : des séquences pédagogiques destinées à sensibiliser collégiens et lycéens aux mécanismes et aux dangers de la mafia. Portée par l’Éducation nationale avec l’appui de partenaires publics et privés, l’initiative doit être testée dans une dizaine de classes avant une généralisation prévue l’année prochaine.
Par Caroline Ettori
La mafia serait une pieuvre tapie dans l’ombre, une araignée guettant sa proie. Faux. La force de la mafia est justement de ne pas rester en retrait. Elle infiltre l’économie, la politique, la vie quotidienne. Elle pressionne, menace, tue. Parce qu’elle se glisse partout, la riposte doit être partout, des tribunaux aux assemblées en passant par les salles de classe.
Le phénomène a trop longtemps été ignoré dans l’île. Pire, il a été accepté entre peur et résignation. Les facteurs sont nombreux et divers : historique, sociologique, sémantique… Avec le temps, profitant d’une réponse régalienne pour le moins insuffisante, l’étau mafieux s’est resserré autour des élus et des acteurs économiques asphyxiant l’ensemble de la société.
Jusqu’à ce que cette société reprenne son souffle à travers la création en 2019 de deux collectifs, Maffia Nò, A Vita Iè et le collectif anti-mafia Massimu Susini. Depuis, les deux organisations n’ont eu de cesse d’alerter les pouvoirs publics. Elles ont multiplié les propositions, les rassemblements, les ateliers pour que les choses changent enfin. Une session extraordinaire de l’assemblée de Corse sera finalement convoquée, des travaux organisés, des rapports restitués. Si les discours traduisent une urgence à agir, les actes se font attendre, certains votes déroutent.
Une réponse éducative essentielle
Pourtant tout est là ; les réponses juridiques pour le volet répressif mais aussi le volet culturel et scolaire pour sensibiliser et prévenir. « Ce n’est pas uniquement un sujet de police et de justice, cela concerne toute la société et donc la jeunesse que l’Éducation nationale doit former », souligne le recteur de l’académie de Corse Rémi-François Paolini. Dès son arrivée en juillet 2024 et ses premières rencontres avec le président du conseil exécutif Gilles Simeoni, Rémi-François Paolini manifeste sa volonté d’inscrire le volet pédagogique dans la feuille de route académique. Rapidement, une large concertation rassemble les futurs acteurs et partenaires d’une initiative jusque-là inédite. Inspecteurs d’académie, enseignants, représentants de la justice, de la préfecture, de la Collectivité de Corse, les deux collectifs s’accordent pour élaborer une réponse d’une ampleur sans précédent.
Le dispositif, des séquences pédagogiques de sensibilisation aux risques liés à la mafia, concernera toutes les classes de la quatrième à la terminale dans les collèges et lycées généraux comme professionnels de l’île. Ces interventions feront partie du programme d’enseignement moral et civique adossé au cours d’histoire‑géographie. Sans exclusive. Toutes les disciplines seront mises à contribution selon les problématiques : philosophie, sciences économiques et sociales, ateliers de cinéma, de théâtre ou encore langue corse.
« Nous sommes désormais dans la phase opérationnelle et l’école a un rôle essentiel à jouer », poursuit le recteur. L’école forme des citoyens libres, conscients, responsables. Ces valeurs s’opposent au phénomène mafieux qui vit de prédation et de destruction. » L’école comme rempart, l’école comme éclaireur. « Les jeunes ne savent pas ce que sont ces phénomènes. Il est essentiel de les informer sur la réalité derrière le mythe pour prévenir de certaines tentations. » D’ailleurs une ouverture vers les familles est également envisagée dans certains cas pour renforcer la prévention.
Déconstruire le mythe
En Corse, la violence et ses représentations ont souvent été idéalisées : « On a romantisé certaines incarnations », constate Marcel Jureczek, enseignant de langue corse au lycée Laetitia d’Ajaccio et membre fondateur du Collectif Massimu Susini. Avec ses élèves de terminale, il travaille sur ces représentations symboliques. « L’objectif est de déconstruire. On parle du bandit, du voyou, du clandestin et aujourd’hui du mafieux. Même s’il n’y a pas de continuité historique entre ces figures, elles expriment toutes une forme de violence. La mafia a pu éclore sur les ruines de la lutte armée et les choix économiques faits pour l’île, le libéralisme à tous crins, lui ont permis de prospérer. »
Les réactions en classe varient : surprise, débat, parfois désaccord. « Ils sont toujours assez surpris lorsque je leur annonce que la violence englobe aussi le clandestin », raconte l’enseignant. Pour lui, le but est clair : « J’espère que le débat et l’esprit critique sortiront de nos classes et interrogeront notre société. Et ne plus jamais entendre “ça a toujours été comme ça”. Cela ne veut rien dire. La violence a entaché notre identité mais elle ne la définit pas. », ajoute‑t‑il.
Tous les acteurs impliqués soulignent l’importance de bien nommer les choses. Le flou, l’approximation n’ont pas leur place dans cette lutte. Au sein de la préfecture de Corse, le coordonnateur pour la sécurité Arnaud Vieules revient sur l’engagement de son service : « Nous avons fourni des éléments de langage adaptés au jeune public. Ces fiches portent sur le nombre de bandes criminelles sur le territoire, leur implantation, sur la conduite d’une enquête, la question du blanchiment d’argent, sur la coordination des services… Il s’agit d’avoir une photographie de ce qu’est la problématique mafieuse en Corse. »
Former et accompagner les équipes
Dans ce cadre, la formation des professeurs sera un élément central du dispositif. « La préparation se fera avec beaucoup de rigueur et de sérieux. reprend Rémi-François Paolini. Actuellement nous recueillons les contributions des différents partenaires pour avoir une vision précise du phénomène mafieux, de son fonctionnement, de ce qu’il implique mais aussi de ce que les personnes engagées dans ces mouvements encourent en cas d’arrestation et de condamnations. » De la même manière, le recteur insiste sur le travail qui sera fait envers les victimes, leurs droits et les recours dont elles disposent. « Quand on subit ce phénomène, il n’y a rien de pire que de se sentir seul. Les victimes doivent savoir qu’elles sont soutenues par les institutions et par la société dans son ensemble. Et que nous n’avons pas peur de parler de cette violence. »
Une fois tous les éléments d’information compilés, la communauté éducative décidera des thématiques à aborder pour chaque niveau de classe, de comment l’aborder, à travers quelle matière et si un intervenant, avocat, journaliste, juge, policier ou autre peut être pertinent pour faire passer le message. Dans ce cas, chaque intervention sera scrupuleusement travaillée en amont.
Dès le mois d’octobre, la méthodologie sera affinée à l’occasion d’un voyage d’étude en Italie. Une délégation corse fera le déplacement pour observer comment les professeurs de la Botte s’adressent aux élèves et quelle approche est à privilégier selon les sujets.
Après ce voyage, une phase de tests sera mise en place dans une dizaine de classes et permettra d’ajuster les séquences si nécessaire. L’expérimentation sera essentielle dans la formation des professeurs qui seront également accompagnés au moment de la généralisation du dispositif en 2026.
Un engagement sur le long terme
Autre certitude du côté des partenaires : la nécessité d’inscrire leur action dans la durée pour proposer une autre modèle de société. « Éduquer, éduquer à la démocratie fait partie de la panoplie des réponses au phénomène mafieux et peut être l’étape clé de la lutte. Les enfants doivent savoir que le modèle criminel peut être attractif mais qu’il aboutit toujours à une impasse, à de l’oppression », rappelle Arnaud Vieules.
Pour Marcel Jureczek, il sera impossible de gagner cette lutte en quelques années. « L’école peut être le terreau du projet de société de demain. Seule l’école peut jouer ce rôle. Notre responsabilité est de donner aux élèves les outils intellectuels et symboliques nécessaires pour qu’ils comprennent leur environnement. Sans jugement, sans faire de leçons de morale. » D’autant plus quand certains jeunes sont concernés par ce type de violence. Victimes, apparentés, proches de familles mafieuses, leur vie semble déjà déterminée. Pourtant le professeur refuse cette fatalité. « À l’école, on émet un son de cloche différent du brouhaha général. Nous représentons une dissonance cognitive et pour certains jeunes, ça marche. Quand ils comparent ce qu’ils ont appris, ce qu’ils ont cru comprendre et la réalité des choses, on assiste parfois à un véritable éveil. »
Avec ce projet, la Corse pourrait devenir un laboratoire pédagogique : informer les jeunes, déconstruire les représentations et, à terme, contribuer à éveiller les esprits sur ces dérives criminelles et leurs conséquences. « Ce dispositif prévoit deux à trois heures de sensibilisation par année scolaire. Notre objectif est de semer des graines de conscience. J’ai l’espérance que l’on se retrouve dans un apaisement plus marqué de la société », avance le recteur.
Pour Marcel, l’engagement éducatif est une condition de survie sociale : « Je veux que mes élèves soient acteurs de la Corse de demain. Nous sommes face à un véritable choix de société. Je ne sais pas si nous allons réussir à changer les choses mais ce qui est certain c’est que nous sommes condamnés à essayer. »